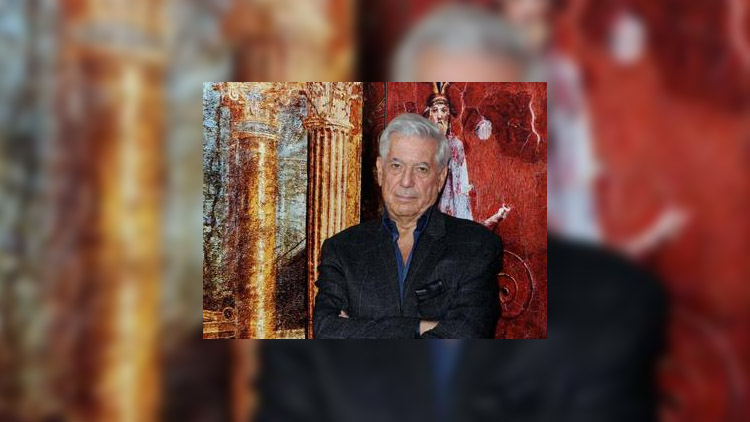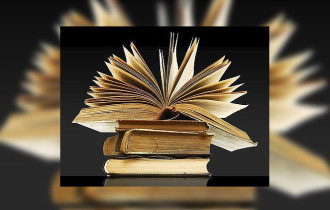Mario Vargas Llosa : éloge de la littérature
« La lecture agrandit l’âme, et un ami éclairé la console. » En écho à ce propos de Voltaire, Le Monde des Livres, sous la plume de Florence Noiville, vient de publier un article qui sort vraiment du lot commun. Intitulé « Mario Vargas Llosa, guérisseur public« , cet article, que m’a signalé mon ami Marcel Croes, fait un éloge enthousiaste, presque dythirambique même, de la littérature et de la lecture en particulier.
Que l’on en juge : « Pour Mario Vargas Llosa, est-il écrit, la littérature sert à panser. Oui, comme ça, avec un « a ». Comme on panse une blessure. Elle soigne, elle calme, elle soulage. Parfois même, elle permet de cicatriser. Tout à la fois pensée et pansement… »
« Cela vous paraît abstrait ? Le Prix Nobel se met à rire. Renversé dans un canapé de son bel appartement parisien, près de Saint-Sulpice, il raconte comment il en est venu, très concrètement, à cette idée de « livre-médecin ». « C’était il y a quelques années, au cours d’un voyage entre Buenos Aires et Madrid, dit-il. A l’aéroport d’Ezeiza, j’avais acheté un ouvrage d’Alejo Carpentier, Le Royaume de ce monde… ». A l’époque, Vargas Llosa souffrait d’un mal chronique, la peur de l’avion. Il avait pourtant passé des années à « monter et descendre de ces bolides aériens comme on change de chemise ». Mais soudain, allez savoir pourquoi, la sueur froide, la peur. « Et rien qui puisse les combattre, ni le whisky, ni les anxiolytiques, ni les comprimés pour dormir… » Rien sauf, ce jour-là, un Carpentier miraculeusement dosé qui, sans qu’il s’en aperçoive, propulsa son imagination hors de la cabine jusqu’à l’atterrissage. »
Au premier abord, on peut bien sûr sourire devant cette affirmation. Mais, poursuit l’article du Monde des Livres, « ces effets étonnants de la littérature, Vargas Llosa les connaît depuis toujours. Et, pourtant, il semble n’en être jamais complètement revenu. Au point qu’à 75 ans, au moment d’écrire son discours de réception du prix Nobel, c’est cela qu’il a voulu faire. Un éloge vibrant – encore tout nimbé d’émerveillement enfantin – de la lecture et de la fiction. « La lecture dissipe le chaos, embellit la laideur, éternise l’instant et fait de la mort un spectacle », écrit-il dans Eloge de la lecture et de la fiction, qui paraît ces jours-ci chez Gallimard. »
L’article est à lire intégralement, tout comme il faut lire intégralement le discours qu’il a prononcé le 7 décembre 2010, quand il a reçu le prix Nobel de Littérature. Un discours somptueux, parsemé de phrases ciselées qui témoignent à l’évidence du génie de cet écrivain :
Petit florilège de ce texte intitulé « Eloge de la lecture et de la fiction » :
« Flaubert m’a enseigné que le talent est une discipline tenace et une longue patience. Faulkner, que la forme – écriture et structure – est ce qui grandit ou appauvrit les sujets. Martorell, Cervantès, Dickens, Balzac, Tolstoï, Conrad, Thomas Mann, que le nombre et l’ambition sont aussi importants dans un roman que l’habileté stylistique et la stratégie narrative. Sartre, que les mots sont des actes et qu’un roman, une pièce de théâtre, un essai, engagés dans l’actualité, peuvent changer le cours de l’histoire. Camus et Orwell, qu’une littérature dépourvue de morale est inhumaine, et Malraux, que l’héroïsme et la poésie épique avaient leur place dans l’actualité autant qu’à l’époque des Argonautes, l’Iliade et l’Odyssée. »
« Sans les fictions nous serions moins conscients de l’importance de la liberté qui rend vivable la vie, et de l’enfer qu’elle devient quand cette liberté est foulée aux pieds par un tyran, une idéologie ou une religion. Que ceux qui doutent que la littérature, qui nous plonge dans le rêve de la beauté et du bonheur, nous alerte, de surcroît, contre toute forme d’oppression, se demandent pourquoi tous les régimes soucieux de contrôler la conduite des citoyens depuis le berceau jusqu’au tombeau, la redoutent au point d’établir des systèmes de censure pour la réprimer et surveillent avec tant de suspicion les écrivains indépendants. Ces régimes savent bien, en effet, le risque pris à laisser l’imagination discourir dans les livres, et combien séditieuses deviennent les fictions quand le lecteur compare la liberté qui les rend possibles et s’y étale, avec l’obscurantisme et la peur qui le guettent dans le monde réel. »
« … Raymond Aron, Jean-François Revel, Isaiah Berlin et Karl Popper (furent les mâitres) à qui je dois ma revalorisation de la culture démocratique et des sociétés ouvertes. Ils furent un exemple de lucidité et de hardiesse quand l’intelligentsia de l’Occident semblait, par frivolité ou opportunisme, avoir succombé au charme du socialisme soviétique ou, pire encore, au sabbat sanguinaire de la révolution culturelle chinoise. »
« De toutes les années que j’ai vécues sur le sol espagnol, je me rappelle dans leur fulgurance les cinq ans passés dans ma chère Barcelone au début des années soixante-dix. La dictature de Franco était toujours debout et fusillait encore, mais c’était déjà un fossile effiloché, et, surtout dans le domaine de la culture, incapable de conserver les contrôles de naguère. Des failles s’ouvraient que la censure ne parvenait pas à colmater et c’est par ces entrebâillements que la société espagnole absorbait de nouvelles idées, des livres, des courants de pensée, des valeurs et des formes artistiques jusque là interdits pour cause de subversion. »
« Je déteste toute forme de nationalisme, d’idéologie – ou plutôt de religion – provinciale, aux idées courtes et exclusives, qui rogne l’horizon intellectuel et dissimule en son sein des préjugés ethniques et racistes, car elle transforme en valeur suprême, en privilège moral et ontologique, la circonstance fortuite du lieu de naissance. En même temps que la religion, le nationalisme a été la cause des pires boucheries de l’histoire, comme celle des deux guerres mondiales et de la saignée actuelle au Moyen-Orient. Rien n’a contribué autant que le nationalisme à la balkanisation de l’Amérique latine, ensanglantée par des combats et des litiges insensés, et gaspillant des ressources astronomiques en achat d’armes au lieu de construire écoles, bibliothèques et hôpitaux. »
Pour en revenir à la littérature :
« J’avais onze ans et, dès lors, tout changea. Je perdis mon innocence et découvris la solitude, l’autorité, la vie adulte et la peur. Mon salut fut de lire, lire les bons livres, me réfugier dans ces mondes où vivre était exaltant, intense, une aventure après l’autre, où je pouvais me sentir libre et être à nouveau heureux. Et d’écrire, en cachette, comme quelqu’un qui se livre à un vice inavouable, à une passion interdite. La littérature cessa d’être un jeu, pour devenir une façon de résister à l’adversité, de protester, de me révolter, d’échapper à l’intolérable : ma raison de vivre. Dès lors et jusqu’à présent, dans toutes les circonstances où je me suis senti abattu ou meurtri et au bord du désespoir, me livrer corps et âme à mon travail de fabulateur a été la lumière qui signale la sortie du tunnel, la planche de salut qui porte le naufragé jusqu’au rivage. »
« « Écrire est une manière de vivre », a dit Flaubert. Oui, assurément, une manière de vivre dans l’illusion et la joie, avec un feu crépitant dans la tête, en luttant contre les mots indociles jusqu’à les maîtriser, en explorant le vaste monde comme un chasseur derrière des proies convoitées pour alimenter la fiction en herbe et apaiser cet appétit vorace de toute histoire qui, en grossissant, voudrait avaler toutes les histoires. Arriver à sentir le vertige auquel nous pousse un roman en gestation, quand il prend forme et semble commencer à vivre pour son propre compte, avec des personnages qui bougent, agissent, pensent, sentent et exigent respect et considération, auxquels on ne peut plus imposer arbitrairement une conduite et qu’on ne peut priver de leur libre-arbitre sans les tuer, sans que l’histoire perde son pouvoir de persuasion, telle est l’expérience qui me fascine tout autant que la première fois, aussi pleine et vertigineuse que lorsqu’on fait l’amour avec la femme aimée des jours, des semaines et des mois, sans s’arrêter. »
« La littérature est une représentation fallacieuse de la vie qui, néanmoins, nous aide à mieux la comprendre, à nous orienter dans le labyrinthe dans lequel nous sommes nés, que nous traversons et où nous mourons. Elle nous dédommage des revers et des frustrations que nous inflige la vie véritable et grâce à elle nous déchiffrons, du moins partiellement, ce hiéroglyphe qu’est souvent l’existence pour la grande majorité des êtres humains, principalement pour nous, qui abritons plus de doutes que de certitudes, et avouons notre perplexité devant des sujets tels que la transcendance, le destin individuel et collectif, l’âme, le sens ou le non-sens de l’histoire, l’en-deçà et l’au-delà de la connaissance rationnelle. »
« Aussi faut-il le répéter sans cesse jusqu’à en convaincre les nouvelles générations : la fiction est plus qu’un divertissement, plus qu’un exercice intellectuel qui aiguise la sensibilité et éveille l’esprit critique. C’est une nécessité indispensable pour que la civilisation continue d’exister, en se renouvelant et en conservant en nous le meilleur de l’humain. Pour que nous ne revenions pas à la barbarie de la non-communication et que la vie ne se réduise pas au pragmatisme des spécialistes qui voient les choses en profondeur mais ignorent ce qui les entoure, précède et prolonge. Pour qu’après avoir inventé les machines qui nous servent nous ne devenions pas leurs esclaves et serviteurs. Et parce qu’un monde sans littérature serait un monde sans désirs, sans idéal, sans insolence, un monde d’automates privés de ce qui fait que l’être humain le soit vraiment : la capacité de sortir de soi-même pour devenir un autre et des autres, modelés dans l’argile de nos rêves. »